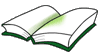| Titre : |
L' évolution du tragique racinien |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Jean Rohou (1934-....), Auteur |
| Editeur : |
Paris : Sedes |
| Année de publication : |
1991 |
| Collection : |
Collection Littérature (Paris. 197?)., ISSN 0249-3292 |
| Importance : |
386 p. |
| Présentation : |
couv. ill. |
| Format : |
18 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7181-1669-3 |
| Prix : |
149 F |
| Note générale : |
Jean ROHOU est professeur à l'Université de Rennes II, il a consacré ses thèses à Racine. |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
"phèdre" "andromaque" "tragédie" |
| Index. décimale : |
T Théâtre |
| Résumé : |
Les onze tragédies de Racine se ressemblent.
La plupart ont la même structure triangulaire : à la base, un sujet déchu dévoré d'un besoin essentiel et impossible à satisfaire, car il vise son antipode - l'être idéal qui le nie - et il se heurte à l'interdit, au Père, à Dieu. Mais cette structure évolue selon un parcours cohérent. A l'expiation frénétiquement masochiste de la faute originelle, chez un sujet terrorisé par le Père (La Thébaïde), succède la révolte contre le Père.
Après deux échecs (Alexandre, Andromaque), celui-ci est virtuellement éliminé à la fin de Britannicus et Bérénice commence juste après la mort de l'empereur, père de Titus, qui pouvait s'opposer à son désir. Mais Titus découvre que la liberté est surtout responsabilité, que la loi est désormais inscrite dans sa conscience, qu'il lui faut renoncer au désir qui était son principe. A partir de là, nous assistons donc au retour progressif du Père, d'abord tyrannique (Bajazet) puis révéré (Mithridate), tandis que le sujet du désir devient de plus en plus conscient de sa déchéance et que les figures idéales tombent dans la concupiscence coupable (Atalide et Bajazet, Monime et Xipharès, plus tard Hippolyte et même Joas) : la valeur n'est pas de ce monde.
Dans Iphigénie et Phèdre, tandis que le père temporel tombe dans l'impuissance, la loi devient religieuse : dans Esther et Athalie, le Père va trouver sa véritable figure, celle de Dieu. Complétant et nuançant cette analyse de la structure psychique des tragédies, l'étude des différents personnages, du lexique, de la dramaturgie, des transformations que Racine fait subir à ses sources permet de restituer à la fois une évolution d'ensemble et la personnalité de chaque pièce. |
| Note de contenu : |
Bibliographie
Table des matières |
| Type de documents : |
écrits |
| Permalink : |
http://172.19.28.25/index.php?lvl=notice_display&id=940 |
L' évolution du tragique racinien [texte imprimé] / Jean Rohou (1934-....), Auteur . - Paris : Sedes, 1991 . - 386 p. : couv. ill. ; 18 cm. - ( Collection Littérature (Paris. 197?)., ISSN 0249-3292) . ISBN : 978-2-7181-1669-3 : 149 F Jean ROHOU est professeur à l'Université de Rennes II, il a consacré ses thèses à Racine. Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
"phèdre" "andromaque" "tragédie" |
| Index. décimale : |
T Théâtre |
| Résumé : |
Les onze tragédies de Racine se ressemblent.
La plupart ont la même structure triangulaire : à la base, un sujet déchu dévoré d'un besoin essentiel et impossible à satisfaire, car il vise son antipode - l'être idéal qui le nie - et il se heurte à l'interdit, au Père, à Dieu. Mais cette structure évolue selon un parcours cohérent. A l'expiation frénétiquement masochiste de la faute originelle, chez un sujet terrorisé par le Père (La Thébaïde), succède la révolte contre le Père.
Après deux échecs (Alexandre, Andromaque), celui-ci est virtuellement éliminé à la fin de Britannicus et Bérénice commence juste après la mort de l'empereur, père de Titus, qui pouvait s'opposer à son désir. Mais Titus découvre que la liberté est surtout responsabilité, que la loi est désormais inscrite dans sa conscience, qu'il lui faut renoncer au désir qui était son principe. A partir de là, nous assistons donc au retour progressif du Père, d'abord tyrannique (Bajazet) puis révéré (Mithridate), tandis que le sujet du désir devient de plus en plus conscient de sa déchéance et que les figures idéales tombent dans la concupiscence coupable (Atalide et Bajazet, Monime et Xipharès, plus tard Hippolyte et même Joas) : la valeur n'est pas de ce monde.
Dans Iphigénie et Phèdre, tandis que le père temporel tombe dans l'impuissance, la loi devient religieuse : dans Esther et Athalie, le Père va trouver sa véritable figure, celle de Dieu. Complétant et nuançant cette analyse de la structure psychique des tragédies, l'étude des différents personnages, du lexique, de la dramaturgie, des transformations que Racine fait subir à ses sources permet de restituer à la fois une évolution d'ensemble et la personnalité de chaque pièce. |
| Note de contenu : |
Bibliographie
Table des matières |
| Type de documents : |
écrits |
| Permalink : |
http://172.19.28.25/index.php?lvl=notice_display&id=940 |
|


 Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la rechercheBérénice / Jean Racine
Bérénice / Jean Racine
L' évolution du tragique racinien / Jean Rohou
Jean Racine / Jean Rohou